Accueil Polémiques Les enfants du numérique : une génération de « malades » ?
Les enfants du numérique : une génération de « malades » ?
Angoisses, addictions, renfermement, insomnies, maladies : les risques liés au numérique sont à prendre au sérieux. Les jeunes sont touchés par de nouvelles maladies mentales ou décrites comme telles : nomophobie, selfitisme, fobo, syndrome des vibrations fantômes. La liste est longue et n’a pas fini de s’allonger. Prochaine sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé : l’addiction aux jeux vidéo. Les jeunes ont trouvé dans le numérique un refuge face à leur mal-être, mais il semble finalement aggraver leur solitude.
Déjà en 1995 Mark Griffiths, psychologue américain spécialisé dans les addictions comportementales, s’inquiétait du développement des « dépendances technologiques ». Depuis, de nombreuses recherches ont été effectuées sur l’addiction à Internet, la dépendance aux jeux vidéo en ligne, au téléphone mobile ou encore aux médias sociaux. Et les scientifiques ont évalué que ces pratiques addictives pouvaient résulter de troubles de la santé mentale.
Ainsi, en 2015, un nouveau syndrome a vu le jour : le Fobo (pour Fear Of Being Offline). Celui-ci se caractérise par la peur d’être hors ligne, d’être déconnecté. Depuis, la liste s’allonge et après le syndrome des vibrations fantômes et la « nomophobie », qui se traduit par l’angoisse d’être séparé de son téléphone mobile, le selfitisime vient d’être décrit comme une maladie mentale.
Le selfitisme : du plaisir à l’addiction
Pratique en plein boom avec le développement des réseaux sociaux et en particulier d’applications comme Instagram et Snapchat, la passion des seflies peut vite tourner à l’addiction. D’abord soupçonnée d’être une simple pratique narcissique, la prise obsessionnelle de selfies n’est autre que le symptôme d’une maladie psychique, selon une étude réalisée sur 400 participants par l’université de Nottingham Trent (Royaume-Uni) et la Thiagarajar School of Management (Inde).
La démarche est simple : prendre une photo de soi-même (avec la caméra frontale de son smartphone en tendant le bras bien droit, à l’aide d’un miroir ou grâce à une perche à selfie), retoucher les couleurs, changer l’arrière-plan, et ajouter d’autres effets, puis publier le cliché sur les réseaux sociaux. Tellement simple qu’elle est bien souvent répétitive. En effet, les « selfites » se prennent en photo entre une à quatre fois par jour en moyenne et jusqu’à huit fois par jour pour 35 % d’entre eux. Mais, plus surprenant, une fois sur trois, ces photos ne sont pas publiées.
Selon Janarthanan Balakrishnan et Mark D. Griffiths, à l’origine de l’étude, la personne est atteinte d’un léger trouble mental quand elle prend quotidiennement trois selfies, mais ne les publie pas. Le stade aigu est caractérisé selon eux par l’envie de mettre les photos en ligne, tandis que le stade chronique est celui où la personne publie au moins 6 selfies par jour.
Cette maladie toucherait majoritairement les garçons (57,5%) et les jeunes de 16 à 25 ans (90 %). La personne typique atteinte de selfitisme est une personne qui n’est pas sûre d’elle et tente d’attirer l’attention sur soi. À travers la publication de selfies, c’est avant tout une mise en scène valorisante du quotidien et la recherche d’attention qui sont recherchées, au même titre qu’une amélioration de l’humeur et de la confiance en soi. Mais derrière, il y a également une forme de conformité sociale : on cherche à faire comme les autres ; mais aussi une forme de compétition : on veut plus de cœurs sur nos photos.
Ainsi, les personnes souffrant de selfitisme essayent de compenser leur manque de confiance en eux en étalant leur vie sur les réseaux sociaux. Et ils deviennent rapidement accros aux « likes » et commentaires boostant leur égo. Le problème selon Émilie Danchin, photographe et thérapeute en psychosomatique relationnelle, experte en photothérapie, est que « ces jeunes font une photo, la regardent à peine et passent à autre chose ». Alors qu’ils devraient « s’arrêter et prendre le temps de regarder la photo, voire de l’imprimer pour l’interroger et rechercher les émotions ».
En effet, selon la photographe qui utilise la photo comme outil d’exploration de soi, « que les personnes fassent des photographies peut être très intéressant. C’est une pratique normale à l’adolescence, période de grands changements : on change, notre corps change et, en face, on a besoin de se construire. La pratique de l’autoportrait peut alors soutenir et renforcer cette construction de l’identité. Cela permet d’avoir une bonne estime de soi. Mais bien souvent, ça n’a plus rien à voir avec une pratique photographique : il n’y a aucune réflexion sur notre existence, on se créer une autre identité dans nos selfies, on essaye de ressembler à quelqu’un d’autre et notre existence dépend du nombre de “j’aime” qu’elle va avoir ».
L’addiction aux jeux vidéo : maladie mentale ?
Autre moyen de divertissement des jeunes lié au numérique, les jeux vidéo peuvent provoquer une véritable addiction. À tel point que le « trouble du jeu vidéo » (gaming disorder) est en passe de devenir une maladie aux yeux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les joueurs ayant « un comportement lié aux jeux vidéo sur Internet ou hors ligne, qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité croissante accordée au jeu par rapport à d’autres activités, au point qu’il prenne le pas sur d’autres centres d’intérêt » depuis au moins un an seront alors considérés comme souffrant de ce trouble.
Là encore, la maladie touche principalement les jeunes : 8 % des 8-18 ans seraient accros aux jeux vidéo. Les raisons de ce trouble sont multiples. Notre double virtuel évolue dans un monde fantastique, un monde sans fin et dans lequel il fait partie d’un groupe. Il est donc parfois difficile de se séparer de son « avatar », dont la vie est bien souvent plus palpitante que la nôtre. Le jeu est finalement un refuge dans lequel on se sent bien et que l’on ne veut donc pas quitter.
Certes, les conséquences de cet isolement virtuel sur la vraie vie peuvent être graves. Toutefois, la qualification de la difficulté à se déconnecter des jeux vidéo comme une maladie par l’OMS pose question. Le problème lié à cette pratique est qu’il est parfois impossible de s’arrêter de jouer, mais l’existence d’un syndrome de sevrage physiologique et d’un risque majeur de rechute, éléments déterminants dans l’addiction, n’est pas caractéristique du jeu. D’ailleurs, la plupart des joueurs arrivent à s’en sortir sans l’aide de personne une fois l’adolescence terminée ou quand les problèmes plus personnels qui les avaient poussés à s’isoler dans le jeu se résolvent.
Alors, pourquoi l’OMS a-t-elle pris une telle décision ? La réponse se trouve peut-être du côté des laboratoires pharmaceutiques. En effet, qualifier les troubles du jeu vidéo comme une maladie implique que les personnes reconnues comme malades se verront délivrer une prescription médicamenteuse remboursée par la sécurité sociale. Or, les labos pensent avoir mis au point « des molécules spécialement ciblées sur les dépressions adolescentes avec comportements compulsifs », ce qui est évidemment le cas chez les joueurs.
Le problème ? Selon Émilie Danchin, « donner des médicaments à des jeunes qui ont une fragilité narcissique comporte un risque de les rendre accros aux médicaments. Il faut commencer par questionner sa pratique et se demander ce qui fait que l’on a une personnalité dépendante ».
On essaye la détox ?
Alors avant d’en venir à un traitement médicamenteux, la première chose à faire est de questionner sa pratique, de se demander ce qui nous pousse à jouer ou à nous prendre en photo huit fois par jour. Et, réflexion faite, pourquoi ne pas essayer la détox ? Pendant une semaine, pas de console, pas de jeu en ligne, pas de selfie, mais un retour à soi. Vous pouvez également changer de pratique et faire de l’autoportrait pour questionner votre moi intérieur.
Solution plus radicale, vous pouvez également tout couper le temps d’une semaine : wifi, portable, ordinateur et faire l’expérience d’une « détox numérique » pour sortir avec des amis, lire, aller courir et prendre du temps pour vous. Fini l’angoisse de ne plus avoir de réseau, le stress à la réception des notifications, les conversations interrompues par la réception d’un SMS. Cela vous évitera peut-être de faire un « burn-out numérique ».
Parce que oui, même si l’article n’en parle pas directement, le numérique apporte du stress supplémentaire dans nos vies (le stress numérique), à tel point que le droit à la déconnexion est devenu un véritable sujet politique. Il serait en effet temps d’agir comme le souligne Émilie Danchin qui s’inquiète de voir les jeunes du numérique devenir parents sans lever la tête de leur smartphone : « On est moins connecté à ce que l’on fait. Du point de vue affectif on n’est pas là et cela peut avoir des conséquences sur la construction identitaire de l’enfant puisque tout commence dans la capacité à être présent. »
Aller plus loin :
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


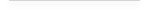 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro  Le jeu vidéo est un refuge dans lequel les jeunes se sentent bien et ont du mal à quitter.
Le jeu vidéo est un refuge dans lequel les jeunes se sentent bien et ont du mal à quitter.
Ados : éteindre les écrans la nuit ?
La pub, ça marche toujours
Des piles goût "beurk"
Médecine de demain ?
Les blessures émotionnelles d'enfance affectent la mortalité à l'âge adulte