
Méthodes vidéos
Cesser de boire, c’est être prêt à multiplier les deuils
En France, tout le monde boit mais personne n’a de problème avec l’alcool. L’alcoolique, c’est toujours l’autre. Et l’ivresse est source de libations, de créations, d’adhésion. Pourtant, des symptômes cliniques à la dépendance, la palette de maladies liées à l’alcool est large, et les médecins mal formés. Entre réflexions scientifique et philosophique, le professeur en médecine Jean-Pierre Aubert nous confie son regard pragmatique sur cette question à laquelle il a récemment consacré un livre.
Jean-Baptiste Talmont
Parler d’alcoolisme entre amis, c’est entendre que l’alcoolique c’est l’autre, celui qui boit dès le matin, qui tremble, qui boit seul, alors c’est quand l’alcoolisme ?
Il y a plusieurs façons de répondre. La première serait de questionner les risques sur la santé de la dose journalière. La réponse c’est : plus de 20 g d’alcool par jour, soit deux verres, est la limite au-delà de laquelle la consommation peut présenter un risque. Évidemment, l’alcoolisme ne débute pas avec une telle consommation. La deuxième réponse, c’est de savoir s’il faut s’inquiéter lorsque l’on est malade suite à sa consommation d’alcool. Ici on met l’accent sur cette multitude de symptômes cliniques qui est liée à la consommation et qui s’améliore dès lors qu’elle cesse. Il s’agit des troubles de la mémoire, des remontées acides, de l’hypertension artérielle, des troubles du caractère. Ces symptômes trahissent une consommation excessive pour notre organisme puisqu’il en souffre. Mais ce n’est toujours pas de l’alcoolisme. La troisième va interroger la notion de liberté. L’alcoolo-dépendance, c’est la perte de sa liberté dans une consommation que l’on ne peut plus modérer et encore moins stopper.
On peut délibérément sacrifier cette liberté et pactiser avec l’alcool. Vous écrivez que c’est un excellent anxiolytique et antidépresseur, du moins pour sa rapidité d’action…
Exactement et c’est un des grands problèmes que suscite l’alcool : c’est que c’est un excellent médicament. C’est à la fois un anxiolytique et un antidépresseur d’action rapide. En 15 minutes maximum, on sent les effets. Du point de vue des anxiolytiques, on dispose de molécules à peu près similaires. Mais en termes de dépression, on n’a rien d’équivalent. C’est dur pour un médecin d’expliquer à un patient déprimé que le traitement qu’on lui prescrit ne fera effet que dans trois semaines. Pour quelqu’un qui a envie de mourir, qui lutte contre les idées suicidaires, la réponse thérapeutique est un peu cinglante.
Mais, vous l’écrivez, c’est un vrai piège…
Oui. On va mal, alors on boit un verre. Du coup on va mieux. Mais comme ça ne dure pas, on reprend un deuxième verre. Le moral remonte, mais moins haut qu’avec le premier verre. Quant à l’effet, il dure encore moins longtemps qu’avec le premier verre. Donc, on reprend un troisième verre et ainsi de suite. Si on devait se représenter la courbe du moral sous alcool, on verrait que les remontées étant toujours moins hautes d’un verre à l’autre et les plongeons toujours plus profonds, la courbe résultante descend inexorablement. On peut dire que l’alcool, puissant antidépresseur, est finalement un puissant dépresseur.
Outre cet aspect médicamenteux, l’alcool revêt bien des dimensions, sociales, culturelles. Rien qu’en littérature, poètes et écrivains chantent ses louanges quelles que soient les époques et les continents…
La poésie persane, celle d’Omar Khaayam en particulier, est merveilleuse, mais c’est une poésie d’alcool et en pleine terre d’Islam qui plus est. Quand des patients viennent me voir pour des problèmes d’alcool, ce dernier a été source de bénéfices sociaux secondaires très importants. C’est un produit désinhibant qui permet de se sentir mieux en société, surpuissant, qui convoque et met en valeur la virilité des garçons, c’est un euphorisant, on fait de l’esprit. C’est un aspect positif indéniable. Souvent on est perçu et vécu comme un bon vivant. Imaginons le cas de l’Oncle Jean-Pierre. Pendant des années, il a été perçu comme le joyeux drille de la famille qui mettait la bonne ambiance dans les réunions de famille. Un jour, une sœur, une nièce, un cousin va dire que l’Oncle Jean-Pierre, il est un peu lourd quand il a bu ; et puis il a tendance à être un peu grivois ; et puis il s’énerve vite quand il a un verre de trop ; en fait, l’Oncle Jean-Pierre, il a un problème avec l’alcool non ? Dès lors, exit le bon vivant. Il ne suffit que de cette prise de conscience pour que l’Oncle Jean-Pierre chute de son piédestal, soit destitué de son statut de « bon vivant » pour être estampillé « alcoolique ». Et souvent, ça se passe dans son dos. D’une réunion de famille à l’autre, les regards ne sont plus les mêmes, les rires et sourires sont plus sarcastiques, les regards plus gênés. L’Oncle Jean-Pierre comprend vite que la situation a changé sauf que personne ne la lui explique, personne n’ose lui dire franchement. Et quand il prend conscience qu’on le prend pour un alcoolique, il découvre avec stupeur que ce n’est pas qu’une sœur, une nièce, un cousin, mais c’est bien toute la famille, tout l’entourage qui le prennent définitivement pour un alcoolique lourdingue, un peu beauf, pas si drôle. Et “stupeur”, le mot est faible puisqu’à se croire bon vivant mais être considéré comme un poivrot, on vit une disqualification très brutale.
[lireaussi:5860]
Mais cette brutalité ne convoque-t-elle pas la notion de complicité de l’entourage ?
Je pense en effet que nous avons tous souvent rempli le verre d’un proche... Nous jouons des jeux dangereux tout en nous drapant dans la bien-pensance, et en oubliant, dès que nous avons catalogué l'Oncle Jean-Pierre dans le groupe des poivrots, que nous avons bien collaboré, directement en versant un verre, ou indirectement en le cautionnant, à son état.
Malgré cela, l'entourage peut se sentir désemparé. Peut-il parler de sa maladie à un alcoolique et quels sont vos conseils ?
Tout ce que je peux dire, c’est qu’il faut aborder ce sujet, même si c’est au risque de se faire rembarrer. C’est inévitable quasiment. Si vous dites à un proche : « Tu ne devrais pas boire autant, tu ne devrais pas prendre ce verre », il y a de fortes chances que vous entendiez : «De quoi je me mêle ? », « De toute façon je tiens très bien l’alcool », ou encore : « De toute façon tu bois autant que moi, c’est l’hôpital qui se fout de la charité ». Bref, on risque de se prendre une volée de bois vert. Mais ce n’est pas grave. Il faut revenir à la charge, le lendemain ou à un temps plus calme, pour vraiment marquer le coup et expliquer que ça ne sort pas d’un chapeau cette histoire de problème avec l’alcool, et il faut déployer les possibilités d’un dialogue autour de la question de l’alcool. C’est très important parce que c’est une véritable marque d’estime et de courage. On ne parle pas dans le dos de l’alcoolique, mais dans les yeux et avec cœur. Dans un deuxième temps, plus l’alcoolique entendra que sa consommation n’est plus perçue comme de l’hédonisme, mais comme une pathologie, plus les chances que ça percute à un moment ou à un autre sont grandes.
Sur les soins, j’aimerais que vous nous expliquiez le sous-titre de votre livre « Histoire d’alcool : peut-on en parler à son médecin ? ». Quelles sont les problématiques en jeu ?
Les problématiques sont différentes pour le patient et le médecin. Pour le patient, le médecin généraliste est souvent le médecin de la famille. Ça peut être un handicap dès lors que l’on veut aborder les problèmes d’alcool. C’est difficile de le faire avec le médecin de la conjointe ou du conjoint. Le patient peut craindre que l’information se diffuse. Du côté du médecin, généralement, sa première expérience est très négative. Il commence sa carrière par ne pas aimer les alcooliques. Il fait son internat, il est épuisé, les pompiers lui amènent une « crise d’épilepsie » (les pompiers amènent des maladies et pas des malades, un infarctus qu’ils prononcent « infarct’ », un « coma diabétique »). Bref, la crise d’épilepsie en question, c’est un ivrogne qui ne convulse plus mais qui ronfle comme une baraque à frites. Évidemment, il s’est vomi dessus, évidemment il en a mis partout. Il faut le déshabiller, c’est franchement dégoûtant. Outre le vomi, il empeste l’alcool. Quand il se réveille, le gars se demande ce qu’il fait là, il insulte le jeune interne et toute l’équipe, se montre parfois violent physiquement, verbalement quasi systématiquement, il en veut à la terre entière d’être là et n’a qu’une idée en tête, c’est de partir de là. Alors, il se lève, le poing tendu, et file dans les couloirs, avec les fesses à l’air. C’est un peu pathétique. Voilà le premier contact avec un alcoolique. Et en règle générale, prodiguer des soins à une personne qui n’en demande pas par une personne qui ne veut pas spécialement lui en donner parce que le patient est grossier, sale, agressif et potentiellement dangereux physiquement, ça n’établit pas tout de suite une bonne relation. Cette première expérience va être déterminante pour l’interne qui va intégrer que les alcooliques sont des patients détestables et surtout qui ne formulent pas de demande de soin. Là je parle de l’interne qui bien qu’en fin d’études de médecine est encore étudiant. Avec le temps et la pratique, le point de vue des médecins généralistes a tendance, fort heureusement, à évoluer. Mais certains conservent chevillée une difficulté à entrer en contact avec des malades de l’alcool qui remonte à l’expérience négative de leurs toutes premières années d’exercice et de leurs premiers stages. C’est pour ça que je pense qu’il est tout à fait regrettable que dans les premières années de médecine les stages de psychiatrie ne soient pas obligatoires.
Estimez-vous que les médecins sont mal formés ?
Je conclus le livre par « je reviens de loin ». Je reviens de ce monde qui rejetait les alcooliques. J’ai été moi aussi cet interne et jeune médecin qui trouvait insupportables les alcooliques. Je reviens de loin en ce sens où on ne m’a pas bien appris l’alcool. La formation en matière d’alcoologie est franchement indigente. Elle se résume se réduit à la gestion du sevrage. Et pour ceux qui en veulent plus, ils apprendront la cirrhose, l’hépatite alcoolique, la pancréatite, la polynévrite, le syndrome de Korsakoff et sa démence spectaculaire. Mais ça ne reste que des cases entrent certains alcooliques mais qui passe totalement à côté de l’acoolisme. J’en veux un peu aux enseignants que j’ai eu. Quand ils m’ont parlé d’alcool et d’alcooliques, on sentait qu’ils éprouvaient un réel mépris pour les malades. Avant que je ne rencontre des médecins comme Bernard Rueff ou Philippe Battel, je n’ai pas le souvenir d’avoir entendu un discours empathique sur les malades de l’alcool et du fait qu’ils étaient intéressants. Ce que j’ai découvert en disant que je reviens de loin, c’est que ce sont des gens formidables. Et je ne reviens toujours pas qu’on n’ait pas appris à les écouter.
Alors justement, comment un médecin généraliste comme vous prend en charge un malade de l’alcool ?
Avant toute prise en charge, il faut une prise de conscience, et c’est tout un chemin. Il y a quarante ans, quand j’ai débuté, la prise en charge passait uniquement par la sobriété. Par les exigences de ce modèle, le médecin devait s’impliquer dans une relation faite de contrainte avec le patient, parce que la sobriété quand on est alcoolo-dépendant c’est une sacrée histoire. Or, justement, le patient alcoolique est venu au cabinet parce qu’il a bien pris conscience que l’alcool aliénait sa vie. Inéluctablement, surgissait un conflit entre ce désir de liberté et la contrainte imposée par le médecin, qui va “l’enfermer” dans sa sobriété. Pour échapper à cette situation, le médecin peut s’appuyer à présent sur l’entretien motivationnel. Ces techniques, qui ont été conceptualisées par deux psychologues anglo-saxons, sont vraiment dédiées à l’addictologie. Elles permettent au patient, avant tout travail sur le sevrage, de bien identifier son projet par rapport à l’alcool. Il va évaluer les bénéfices qu’il tire de la prise d’alcool, les inconvénients, et les solutions. Le choix sera négocié, décidé, formulé par le patient. Il n’aura ainsi pas la sensation d’être enfermé dans une seule et unique solution thérapeutique, en l’occurrence la sobriété.
En 2018, une étude du ministère de la Santé révélait que le temps moyen que consacrait un généraliste à son patient était de 18 minutes. Est-ce qu’un médecin généraliste a du temps à consacrer à l’écoute et les entretiens motivationnels ?
Contre toute attente, 18 minutes, c’est tout de même assez long. La relation avec une personne en situation de dépendance est en générale très facile à fractionner. Si on est capable d’exprimer des règles, les patients sont parfaitement prêts à les entendre. Seulement il faut les énoncer clairement. Il faut pouvoir dire que l’on en a entendu la demande, qu’elle peut faire l’objet d’une prise en charge sur plusieurs séances, qu’il n’y a pas d’urgence, qu’on est là, et que les séances seront de 15 minutes à chaque fois, une fois par semaine.
Quelles sont les problématiques sociales et familiales que pose le sevrage ? Est-ce que paradoxalement, guérir de l’alcool peut poser des problèmes ?
Il ne faut pas accéder sans la creuser à la demande d’un futur patient qui vont dit : « Je veux arrêter de boire ». Il faut questionner cette demande, l’évaluer. D’une en rappelant que ça ne se fait pas d’un claquement de doigt. De deux, en rappelant qu’il n’y a pas que des avantages à cesser de boire. Cesser de boire, c’est un chemin qui implique de multiples deuils. Il faut évaluer les avantages qu’apportent la consommation d’alcool pour être sûr d’être prêt à cesser de boire. Tout d’abord, il faut travailler sur les conséquences psychologiques de l’arrêt de la boisson. On a vu que l’alcool est un puissant médicament, et ce médicament va disparaître. Les insomnies ne risqueront pas de s’améliorer avec l’arrêt de l’alcool, voire, elles risquent de s’accentuer. À tous les coups, les sueurs vont s’accentuer. Les tremblements ne guériront pas automatiquement à l’arrêt.
Et pour le couple, quelles sont les problématiques du sevrage ?
La sobriété va créer un véritable bouleversement. En premier lieu, il va changer l’équilibre symbolique des deux personnages du couple. Celui qui ne boit plus, va profiter d’immenses bénéfices. Il ne sera plus la personne diminuée et dominée du couple, et il ne supportera plus de l’être. Autre bouleversement lié à l’arrêt de l’alcool, c’est la question de la fiabilité, de la confiance, de l’arrêt des mensonges. Et c’est ici une des plus grandes difficultés que rencontre l’ancien buveur. L’arrêt de l’alcool ne suffit ni à l’ex-conjoint ni à l’entourage pour accorder à nouveau la confiance. On se méfiera toujours. Et il faut souvent bien des années pour que l’étiquette estampillant comme alcoolique l’ancien buveur ne s’efface. Elle s’efface, mais elle colle toujours. L’ancien buveur pourra dire la vérité, être fiable, il y aura toujours une suspicion. La confiance, c’est la pire des choses à perdre, et la plus difficile à récupérer. Avoir été alcoolique, c’est comme avoir fait de la prison. On n’a jamais vraiment purgé sa peine. Et il faut que le patient en prenne bien conscience et se prépare à cet obstacle. C’est extrêmement douloureux à vivre pour l’ancien buveur, surtout quand cela émane – et cela émane inévitablement – du conjoint.
L’alcool trouve également sa place dans la vie sociale. On peut se sentir assez rapidement exclu quand on ne boit plus. Refuser de trinquer n’est pas anodin. Pouvez-vous développer ce qu’implique socialement l’arrêt de l’alcool ?
Oui c’est aussi un des aspects à travailler en amont ou dès lors qu’on les rencontre. En France, la personne qui ne boit pas, et plus particulièrement les hommes, pose problème. Soit il ne boit pas parce qu’il est musulman, soit parce qu’il a eu un problème avec l’alcool. Le fait de ne pas boire, c’est s’exclure vous avez raison. Vous êtes invité à un dîner, à l’apéro, il n’y a que de l’alcool. Le maître ou la maîtresse de maison a sorti un vieux whisky qu’il veut vous faire goûter, le refuser c’est une grossièreté à double détente. La première, vous refusez de goûter un breuvage sorti spécialement pour vous, la deuxième parce que vous soulignez, quand vous dites ne pas boire, que votre hôte n’a pas prévu la chose. En refusant de l’alcool, celui qui ne boit pas peut être doublement mal élevé.
D’ailleurs vous consacrez un chapitre sur la phrase pour laquelle opter quand on arrête de boire : « Je ne bois pas en ce moment », « je ne bois pas », « je ne bois plus »…
Et je préconise « je ne bois plus », parce qu’elle calme tout le jeu. En disant je ne bois plus, c’est affirmer que je buvais, et donc je buvais trop, sinon, je boirais encore. Et tant pis si on passe délibérément pour un alcoolique. Mais comme vous ne buvez plus, vous assumez, et dans un premier temps, ça force le respect. Et comme je dis dans le livre, le fait qu’une personne dise « je ne bois plus », c’est aussi permettre à quelqu’un de l’entourage de réfléchir à sa propre consommation d’alcool. Mais on voit bien que l’arrêt de l’alcool implique une multitude de petits deuils qui sont difficiles à faire. C’est pourquoi, il est très important que ce soit le patient qui formule sa volonté d’arrêter de boire.
Vous écrivez que les malades de l’alcool sont des malades du « trop ». Ils sont « trop » aimant », « trop » sensibles, « trop » agressifs, en somme « trop » émotifs. Quelle est la place de la gestion des émotions dans votre prise en charge médicale ?
Dans la gestion des émotions, j’apprécie beaucoup les thérapies du corps et la méditation en pleine conscience. Elles me semblent très importantes et particulièrement appropriées. Je pense que la relaxation d’une part et la méditation en pleine conscience d’autre part sont des pratiques qui s’intègrent très bien et sont très complémentaires avec le travail sur l’addiction. Quand je parle de relaxation, j’entends le travail du corps en général. Ça peut être des exercices pour se relaxer physiquement, le sport ou encore le yoga, bref, une connexion avec le corps qui permet de canaliser, de faire passer les émotions par une reconnexion voire une épreuve physique. De même, je trouve que la méditation fait partie des choses très adaptées parce qu’elle permet de mieux se rapprocher de ses émotions pour apprendre à les délester de leur poids.
[lireaussi:5793]
Vous consacrez deux chapitres sur la famille. Le couple et l’enfant. Pour le couple, vous rappelez que vivre avec un alcoolique c’est un enfer et que de facto peu de couple survive à l’alcool. Dès lors, pourquoi consacrer un tel chapitre si les liens du couple se dissolvent dans l’alcool ?
Parce que le couple est au cœur des interrogations. Dans la réalité de mes patients alcooliques, si 75 % n’est plus en couple, leur séparation est un des grands facteurs déclencheurs pour venir me consulter. Et il reste 25 % de patients qui souhaitent sauver leur couple. Et le premier levier, c’est d’aider les malades de l’alcool à comprendre la position de l’autre. Le problème des malades c’est qu’ils ne se rendent pas compte de l’enfer qu’ils font vivre. Quand vous vivez avec un malade de l’alcool, vous avez été humilié une multitude de fois. Dans une soirée avec des amis ou en famille, il n’est pas rare que votre conjoint ait été grossier, lourd, violent dans ses propos voire dans ses gestes, qu’il pique du nez à table. Et l’humiliation n’est pas uniquement directe, elle est aussi indirecte à travers le regard des gens qui voient que le conjoint ou la conjointe est ivre. C’est en outre une humiliation parce vous avez été désignée comme conjoint d’alcoolique. Et je ne parle pas de toutes les humiliations du quotidien. Les mots qui dépassent la pensée et dont on ne se souvient plus. Et puis il y a la honte... Je pense à ce patient qui a carrément vomi sur le canapé ou qui a carrément fait pipi dans son pantalon. C’est dur et humiliant à vivre pour le ou la conjointe. Et le pire, c'est que la somme de ces humiliations subies par le conjoint non-alcoolique ne suffiront pas pour qu’il en parle. En règle générale, le conjoint ne parle jamais de vos problèmes d’alcool. Il n’ose jamais en parler à ses amis, ou alors, il faut arriver à de réelles extrémités. Les conjoints sont dans une solitude qui est terriblement dure. Par conséquent, j’essaie de faire comprendre à mon patient que son conjoint a ressenti une humiliation. Le simple fait d’être capable de dire : « Je sais que tu t’es senti(e) humilié(e) à cause de moi », c’est une véritable bouffée d’oxygène pour le conjoint qui enfin est reconnu.
Vous rendez palpable la présence de l’alcool au sein du couple, comme celle d’un tiers. Quels sont les accommodements nécessaires que vous avez pu identifier permettant à un couple de tenir ?
J’ai remarqué deux positions du conjoint non-alcoolique qui sont assez constantes : celle du « flic » et celle du « bon Samaritain ». Le flic contrôle la consommation, la modère, traque la présence de bouteilles dans l’appartement. C’est une position qui peut fonctionner un temps, surtout si elle est à la demande de l’alcoolique. Mais elle ne tient pas bien longtemps parce que le patient va forcément finir par refuser cette contrainte. Il ne supportera plus de se sentir infantilisé et humilié. Pour la position du bon Samaritain, le conjoint non-alcoolique soutient vaille que vaille son conjoint. Il porte sa croix, s’il est marié pour le meilleur et pour le pire, il accepte de supporter le pire. Le bénéfice secondaire est qu’il se sent héroïque. Il en tire un réel bénéfice égotique. L’inconvénient c’est que le conjoint le vit comme de la pitié plus que comme de la compassion, et la pitié c’est humiliant. Du coup l’humiliation est invivable, d’un côté comme de l’autre. Comme aucune des deux positions n’est satisfaisante, on oscille entre les deux.
Passons à l’enfant. Il est un buvard des émotions et vous écrivez qu’avec un parent alcoolique, “les émotions non maîtrisées du parent alcoolique sont une menace perpétuelle pour le petit enfant”…
Ce que l’enfant ne supporte pas c’est l’instabilité émotionnelle, qui lui est terriblement déstabilisante. Tant dans la violence dont l’enfant peut être témoin et qui le heurte profondément que dans l’excès d’émotions, même si elles sont positives. L’alcoolique est par définition dans l’excès émotif et quand il aime son enfant, il l’aime « trop ». Et cette instabilité émotionnelle rend l’enfant extrêmement anxieux. C’est vraiment une dominante importante. Il n’y a pas de régularité dans leur vie. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. L’enfant a appris que demain est une question alors que demain devrait être une joie.
Comment les alcooliques réagissent quand vous abordez la question de l’enfant ?
Ça demande vraiment un gros travail. Par exemple, lorsqu’on sort de l’alcool, on reste dans l’hyperémotivité et notamment dans l’hyper affectivité. Les anciens buveurs se sentent coupable, ils se disent qu’ils ont quelque chose à rattraper par rapport à leur enfant, ils se sentent obligés de les aimer encore plus et au final, aimer trop un enfant c’est tout autant fragilisant pour lui. Donc il faut que les anciens buveurs apprennent à établir ce minimum de distance avec leur enfant, pour ne pas les étouffer par tant d’émotions, pour que les enfants puissent installer leur tranquillité quotidienne. Des émotions pour se racheter, ce n’est jamais bon. Quitter la boisson ce n’est pas une raison pour dévorer l’enfant.
À la question, doit-on boire moins ou pas du tout, vous ne tranchez pas. Pourtant il semble plus difficile de boire moins que de d’arrêter complètement. Il y a toujours un copain de bistrot qui va entrer dans le bar quand on allait partir…
Je suis tout à fait d’accord. Boire moins c’est beaucoup plus dur que de ne plus boire du tout. On a toujours des tentations, des “bonnes” raisons, on est toujours en contact. Avoir opté pour la sobriété, c’est ne plus se soumettre à des situations aussi anodines que très dangereuses. Anodines, parce que c’est anodin de boire un verre avec untel. Mais si tel autre arrive au bar, il est très difficile de refuser de boire avec lui. Ce n’est pas poli, ça ne se fait pas. Et elles sont dangereuses parce qu’à la fin de la journée ou de la soirée, on peut très facilement rentrer à la maison totalement ivre. Cela étant, il y a un truc qui est très pénible dans la sobriété, c’est le côté un peu militant de la chose. C’est-à-dire que même si cela fait cinq ans que vous avez cessé de boire, il y aura toujours des situations où il vous faudra dire que vous ne buvez pas, l’expliquer, le justifier, voire le revendiquer. Et ce qui est pervers, c’est que vous êtes vous-même amené à toujours vous désigner comme alcoolique alors que vous ne l’êtes plus depuis des années. C’est fatiguant de ne pas boire en France.
[lireaussi:7837]
Pour en savoir plus :
- « Histoires d’alcool : peut-on en parler à son médecin ? », de Jean-Pierre Aubert, éd. Cerf, 2021. 20 €.
- « Le dernier verre », du Dr Olivier Ameisen, éd. Denoël, 2014. 8 €.
- « Sans alcool, être sobre est bien plus subversif qu’on ne le pense », de Claire Touzard, éd. Flammarion, 2021. 20 €.
- « Le dernier pour la route, Chronique d’un divorce avec l’alcool », d’Hervé Chabalier, 2006. 7 €.

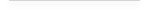 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro 















































































