
Méthodes vidéos
"Le malheur inutile", Dr Alain Gérard
Quand un psychiatre renommé et expérimenté en arrive à se demander s’il est avisé de prescrire un traitement à des patients en souffrance qu’il juge sains, c’est que quelque chose ne tourne pas rond. Le Dr Alain Gérard qui a d’abord modifié sa pratique sans être capable de bien analyser ce changement, est arrivé à la conclusion suivante : aujourd’hui, en tant que praticien, il s’agit davantage d’aider des individus sains à s’adapter à une société malade…
Élise Kuntzelmann
Comment est née l’idée de votre dernier livre* ?
J’avais le sentiment que trop souvent des patients échappaient aux deux types d’outils – basés sur la psychothérapie et le traitement biologique – que je leur proposais. Le contenu des entretiens se modifiait et la part de souffrance qu’ils exprimaient était toujours plus attribuable au monde extérieur. Bien entendu, on parle depuis des années du modèle biopsychosocial. Mais là, j’ai vraiment eu la sensation que ça allait en croissant. Cela me mettait mal à l’aise parce que certains types de prescriptions que je faisais habituellement sans état d’âme me posaient question. Cela a été une forme de remise en question personnelle. J’ai essayé dans un premier temps de formuler ce malaise par écrit pour m’aider moi-même et ensuite pour mieux prendre en charge mes patients. Je n’ai pas voulu écrire un livre de médecine ou de psychiatrie mais un texte destiné à tout un chacun, à travers le vécu de cinq personnes. La jeune infirmière dont je raconte le vécu n’était pas du tout dans la plainte. Elle allait bien jusque-là et était ravie du métier qu’elle exerçait. C’est une pratique particulière de son métier qui a fait que, petit à petit, elle a perdu tout plaisir à le faire.
Qu’appelez-vous " malheur inutile " ?
Dans mon métier, certaines souffrances, comme les psychoses, schizophrénie, démences dégénératives, etc., sont absolument inévitables. En revanche, les cas que je relate dans mon livre sont soumis à des conditions de vie qui pourraient être modifiées. Il est donc inutile de provoquer le malheur chez ces gens-là. Cela les dessert eux et ceux qui les obligent à travailler dans un environnement malsain. Je pense que, même pour une société très tournée vers l’argent, la manière de gérer les vies est mauvaise. Il y a un coût caché à ce malheur. Quand l’entreprise est malsaine, le taux d’absentéisme ou de maladies professionnelles augmente et la productivité diminue. Les salariés se désengagent. Le personnel tourne en permanence. Cette façon de presser les gens est non seulement immorale, mais improductive. Cela ne sert vraiment à rien, c’est inutile.
Que retenir des " cinq histoires de liberté retrouvée " racontées dans votre ouvrage ?
Je me suis rendu compte que ma fonction n’était pas seulement de permettre à mes patients de se réadapter à des conditions intenables. Il s’agissait plutôt, une fois ce stade obtenu, de réfléchir au sens de leur existence, de leur faire retrouver une confiance en eux en leur offrant de ne plus être épouvantablement déprimés ou anxieux. Même dans des périodes socialement difficiles, ils peuvent croire en eux, prendre conscience que la vie telle qu’ils la mènent est une espèce d’aliénation. Ils ne sont pas prisonniers d’un destin. Ils ont toujours une part de liberté, une marge de manœuvre. Quoi qu’on en pense, des alternatives existent.
Il fallait ensuite se servir de ce mieux obtenu dans les premiers temps du traitement pour aller au-delà et être plus exigeant. Or, il se trouve que notre société s’est tellement accélérée que beaucoup de patients n’ont plus envie de s’engager dans des psychothérapies structurées, considérées comme trop longues. Une fois qu’ils sont sortis d’affaire, ils se contentent de cela. Si les conditions extérieures persistent, le mal-être revient en général dans les semaines ou les mois qui suivent.
[lireaussi:7176]
En quoi les maux des individus expriment-ils d’abord ceux du monde ?
Les conditions d’exercice de certains métiers sont devenues infernales. Je pense aux métiers du soin en premier lieu. Suite à la crise du Covid, je suis étonné qu’il n’y ait pas plus de casse parmi les soignants. Nous nous retrouvons, dans des quantités de domaines, à devoir réévaluer le fonctionnement de secteurs entiers de notre civilisation : réorganiser une médecine de qualité avec l’accessibilité à tous, investir dans le système éducatif pour qu’il fonctionne mieux, réfléchir à l’amélioration de l’organisation de la justice, etc. Nous sommes devant un chantier énorme, qu’à mon avis la population perçoit et qui explique probablement l’affolement actuel devant ce qu’il reste à faire.
Le philosophe Jiddu Krishnamurti disait que ce n’est pas un signe de bonne santé mentale d’être bien adapté à une société malade. Cela se rapproche de votre ressenti…
Oui, je veux aider mes patients en souffrance à refuser de s’adapter à une situation malfaisante, à trouver une alternative. En tout cas, j’ai eu envie d’écrire ce livre car je me suis aperçu, à tort ou à raison, j’espère à raison, que cela faisait désormais partie de mon travail de soutenir ces alternatives de vie. Certains dirigeants que j’ai reçus en consultation m’ont dit qu’ils pouvaient exiger n’importe quoi de leurs salariés, qu’ils acceptaient docilement, sans limites. Il y a quelques années, un patron de l’industrie pharmaceutique a demandé que l’on déménage un centre de recherches qui était à l’étranger. Il a exigé de ses équipes de le faire en trois mois. En déménageant rapidement ce centre, il allait économiser quelques mois de loyer. Tous les salariés qui étaient sous son autorité ont attiré son attention sur le caractère quasi impossible de la tâche, mais personne n’a démissionné, ni ne s’y est opposé franchement. Le centre de recherche a déménagé avec une casse épouvantable : des tas de documents ont été perdus, du matériel a été cassé, etc. Et cela a engendré par la suite un retard considérable dans l’activité de recherche. C’est là où, même d’un point de vue économique classique, les exigences que l’on pense être bonnes à très court terme ont un coût pour l’entreprise et un coût humain. Les gens sortent de là démotivés, écœurés, désengagés. Et puis on entend dire que les gens n’aiment plus leur travail. Ce n’est pas vrai. Les gens aiment leur travail à condition que ce soit fait dans des conditions qui ont du sens, qui les autorisent à bien le faire et à se lever le matin en pouvant se regarder dans la glace. L’infirmière à qui on a dit de mettre des boules Quies pour ne plus entendre les appels des patients tout juste opérés ne pouvait plus exercer son métier dans ces conditions. Pourtant elle l’avait choisi et s’y était engagée avec passion. Et ce n’est pas du misérabilisme. Je suis installé à Paris dans le 16e, ma clientèle est plutôt aisée. Le problème a gagné de nombreuses couches de la société.
Considérez-vous, comme on peut l’entendre, que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine ?
La situation de la psychiatrie est terrible. Depuis une trentaine d’années, la tendance lourde est que cette discipline n’a jamais été prise très au sérieux par les gouvernements successifs. À la différence de la cardiologie, de la radiologie, de la pneumologie, qui constituent des spécialités assez homogènes dans leurs profils, la psychiatrie, elle, ne l’est pas. Elle est partagée entre ceux qui s’ancrent plutôt dans le savoir des neurosciences et ceux qui se basent sur les sciences humaines. Les gouvernants ont toujours été piégés par cette espèce de dualité et n’ont pas investi suffisamment dans les équipements, le personnel. Ceci a conduit certains hôpitaux à fonctionner dans des états de misère. Misère qui, pour une part, peut aussi toucher la recherche. Longtemps, la psychiatrie était réservée à des pathologies graves, lourdes. Elle a été purement hospitalière. Une longue évolution a été nécessaire pour que des psychiatres libéraux s’installent et que des gens osent consulter. Aujourd’hui, on a parfois recours aux psychiatres sans être vraiment malade. Il m’arrive de remplir des feuilles de soins pour des patients non malades. Dans le cas de l’infirmière évoquée, c’est la direction de son hôpital qui était malade. Pas elle.
[lireaussi:8181]
Comment améliorer les choses ?
Si je reste dans ma spécialité, je dirais probablement en s’attachant à une formation médicale un peu différente. La sélection des médecins reste tout de même extrêmement discutable : elle demande d’être hypermnésique. Je ne crois pas que ce soit totalement adapté à ce qu’est l’exercice humain d’une spécialité à la fois scientifique, mais aussi très humaine. Plus globalement, il serait bon de reconsidérer les soubassements économiques des domaines de notre société. Arrêter de penser dans le court terme. J’ai assisté progressivement au passage dans le privé de pans entiers de la médecine jugés rentables. Dans le même temps, les domaines lourds sont restés dans la psychiatrie publique. Avant de m’installer en libéral, j’ai été, durant quelques années, chef de service dans le public. J’ai démissionné parce que j’ai assez vite pris conscience que je ne disposerais jamais des moyens et des équipes nécessaires pour faire du bon travail. À la fin de mes études, j’ai poursuivi par un diplôme en économie de la santé. C’est extraordinaire de constater à quel point les économistes avaient prévu les évolutions néfastes de la situation. Mais nous y sommes allés quand même. Rendez-vous compte que, pendant une période, nous avons payé cher des médecins pour prendre leur retraite et ne plus exercer. Aujourd’hui, nous faisons venir de l’étranger des médecins vacataires payés deux à trois fois le salaire des autres, faute de quoi il n’y aurait personne. Ce sont des absurdités basées sur l’idée à court terme de gagner du temps. La comptabilité prend le dessus. Les économies à court terme ne sont pas tenables longtemps dans des domaines en évolution comme la santé.
Quel est le rôle d’un médecin dans tout cela ?
Je pratique un métier dans lequel, avec un peu d’expérience, on fonctionne malheureusement avec des routines, des points de vue préconstitués sur les situations. Il faut, quelle que soit l’ancienneté, faire des efforts pour penser un peu contre soi, pour actualiser les choses. C’est ce qui m’a poussé à sortir de ma zone de compétence, à élargir le spectre.
Une étude menée entre 2016 et 2021 met en avant une explosion des prescriptions d’antidépresseurs chez les 6-17 ans. Comment l’expliquez-vous ?
Le fait que des antidépresseurs soient autorisés chez les enfants est relativement récent. Nous avons longtemps considéré que les inconvénients étaient supérieurs aux avantages.
Ceci s’explique sans doute en partie par le temps de consultation dont disposent les généralistes. Ils n’ont pas vraiment le temps de faire de la psychologie ou de dédramatiser des situations qui, dans l’absolu, ne l’étaient pas. Et ne parlons pas des pédiatres. Certaines prescriptions de psychotropes sont, à coup sûr, faites par excès, pour calmer une plainte.
[lireaussi:8696]
Que vous évoquent les étudiants d’AgroParisTech qui font de la résistance* ? Est-ce un sursaut de salubrité publique ?
On parle de ceux qui sont diplômés. C’est une injustice de la vie : plus on est diplômé, plus on a de libertés sur le destin que l’on choisit. Cela étant dit, lorsque des gens hyper diplômés refusent de servir un système qu’ils jugent opprimant, cela raconte quelque chose d’un environnement, d’une société malade. Quand j’ai démissionné du service public, je me suis dit que je n’avais pas fait sept ans de médecine et quatre ans de psychiatrie pour me faire balader dans des rendez-vous avec des préfets et des sous-préfets. Bref, tout un système qui me faisait perdre mon temps. Bien sûr, choisir une forme de liberté se prépare. On n’est jamais complètement sûr de la décision prise. Il y a toujours une part d’incertitude. Quand je me suis installé en libéral, pendant trois ans, j’ai eu des difficultés économiques réelles parce que personne ne me connaissait dans ce domaine-là.
Quels conseils donneriez-vous à nos lecteurs pour faire face à cette forme d’absurdité de notre monde actuel ?
Je pense que de nos jours – je le constate par exemple chez des gens qui ont pris leur retraite ou qui ne sont plus soumis à ces pressions –, les valeurs de solidarité, d’utilité donnent du sens à leur présence sur terre. Être sur terre pour simplement consommer ne rend pas nécessairement heureux. J’ai eu la chance toute ma vie, en me levant le matin et en partant à mes consultations, d’avoir l’impression de servir à quelque chose. Il y a certains métiers pour lesquels il y a une forme d’évidence à l’utilité. Il y en a d’autres pour lesquels c’est moins immédiat. Lorsque l’on regarde bien notre société, de nombreuses personnes sont engagées dans un travail parfaitement utile à la collectivité. Prenons l’exemple du système hospitalier : depuis les gens qui font le ménage jusqu’au chirurgien qui opère ou au gestionnaire qui, en principe, devrait bien gérer, en passant par les gens qui préparent les repas ou stérilisent le matériel chirurgical, tous sont utiles. À condition qu’on les mette dans des situations tenables. Nous avons la chance, en Europe, d’avoir les moyens de faire vivre heureux nombre d’individus.
[lireaussi:4980]
* Le 30 avril 2022, huit étudiants d’AgroParisTech avaient appelé leurs camarades, lors de leur cérémonie de remise de diplômes, à " déserter " le chemin qui leur est ouvert vers des emplois […] qui participent aux " ravages sociaux et écologiques en cours ".
Aller plus loin
Le malheur inutile, Cinq histoires de liberté retrouvée, du Dr Alain Gérard, éd. Michel Lafon, 160 p., 2023, 16,95 €.

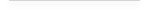 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro 















































































