
Méthodes vidéos
"Les Français vont plus mal qu’il y a quarante ans" Sylvie Wieviorka
Sylvie Wieviorka a exercé la psychiatrie de la fin des années 1970 à nos jours. C’est sur la base de ses consultations qu’elle témoigne dans un livre des immenses bouleversements qui ont traversé la société française en quarante ans. Santé mentale, addictions, troubles chez l’enfant, souffrance au travail : le rapport entre les individus et la société s’est modifié profondément dans de multiples domaines.
Élise Kuntzelmann
Alternative Santé : Quel est a été l’élément déclencheur de la rédaction de votre livre ?
L’idée était d’essayer de participer à la réflexion autour des questions de santé mentale. Plus particulièrement aux rapports entre les problématiques de santé mentale et la société dans son ensemble. J’ai également souhaité montrer, sur la base de mon constat personnel, comment, en quatre décennies, la façon de percevoir le monde s’était considérablement modifiée. Je pense que nous ne sommes pas conscients de l’énormité des bouleversements qui se sont produits dans le domaine des troubles psychiatriques ces quarante dernières années.
Quelles sont les évolutions les plus notables ?
Il y a quarante ans, les psys soignaient, pour l’essentiel, des
personnes présentant des maladies mentales. Autrement dit, qui
consultaient pour des psychoses, des dépressions, etc. En bref, des personnes qui étaient malades, qui se vivaient comme malades et qui consultaient pour demander du soin. Nous sommes passés à une époque où la santé mentale concerne tout le monde.
Je pense que c’est un changement extrêmement important, présentant de bons et de moins bons côtés. Le point positif est l’impact très déstigmatisant. Je veux dire par là qu’il n’y a peut-être pas une telle différence de nature entre des individus présentant des maladies psychiatriques avérées et des gens comme vous et moi, qui ne vont pas trop mal mais qui, de temps en temps, ont de petits coups de blues ou des angoisses. Le côté peut-être plus curieux est que nous avons tendance à psychologiser touteune série de difficultés de la vie sociale et relationnelle qui ne sont, peut-être, pas vraiment du ressort de la psychologie et de la psychiatrie.
[lireaussi:9025]
L’inquiétude quant à sa santé mentale serait en quelque sorte amplifiée par l’intérêt que l’on y porte ?
Oui, je crois beaucoup à cela. Mon point de vue est que si je vous demande comment vous allez, vous allez me répondre que ça va. Puis, si j’insiste en vous demandant si vous dormez bien, si vous mangez bien, si vous n’êtes jamais anxieuse, nous allons finir par trouver quelque chose. Personne, ou alors je pense que cela se révélera pathologique dans un autre sens, ne traverse l’existence sur un tapis de fleurs et le sourire aux lèvres. Plus vous dites à quelqu’un qu’il a l’air d’aller mal, plus il se sent mal.
Vous soulignez la technicité et la pathologisation des termes employés...
Oui. Si l’on prend l’exemple de l’enfance, en 1984, lors de mes consultations, je pouvais entendre : « Mon fils m’épuise, je n’arrive pas à ce qu’il se tienne tranquille. Pouvez-vous me don-ner des conseils ? » Actuellement, ce serait plutôt : « Mon fils souffre de TDAH (Trouble déficit de l’attentionavec ou sans hyperactivité, ndlr). Je pense qu’il faut le mettre sous Ritaline. »
Si l’on adopte une vision optimiste du sujet, on peut se dire
que ces troubles étaient jadis sous-diagnostiqués car l’on ne
connaissait pas ces pathologies. Pour prendre l’exemple du
TDAH, on pensait qu’il s’agissait d’enfants agités, insuppor-tables, dont les parents étaient trop tolérants. Aujourd’hui, on affirme qu’il s’agit d’un trouble neurodéveloppemental. En résumé, si l’on voit les choses positivement, on peut se dire que le problème est aujourd’hui pris en charge. En revanche, la vision plus pessimiste revient à dire que, dès qu’un enfant est un peu agité et que ses parents sont à bout, on le met sous Ritaline. Cela peut être problématique, surtout dans un contexte français où l’on manque de professionnels correctement formés.
[lireaussi:5996]
Biographie de Sylvie Wieviorka

La psychiatre Sylvie Wieviorka a réalisé son internat en région parisienne avant de passer un concours pour devenir praticienne hospitalière. Elle a obtenu un poste de chef de service dans la Somme avant de revenir en région parisienne. Ces vingt dernières années, elle a été responsable d’un centre de soin pour personnes souffrant d’addictions. Elle a également enseigné la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris-VIII. Par ailleurs, elle a encadré de nombreuses formations à la thérapie familiale et continue de former praticiens, psychologues, médecins et travailleurs sociaux à l’approche systémique et à la thérapie familiale.
[lireaussi:8441]
Vous consacrez un chapitre aumonde du travail. Quels sontles changements majeurs ?
Le paradoxe est que, de nos jours, les conditions de travail sont meilleures qu’elles ne l’étaient il y a quarante ou cinquante ans. La semaine compte moins d’heures de travail. Il est, pour certains salariés, possible de télétravailler. Le nombre de jours de congé a augmenté, etc. Or, dans les faits, beaucoup de salariés se plaignent de leur travail. Il me semble pourtant qu’avant, mes patients s’en plaignaient peu et craignaient davantage le chômage.
En me penchant sur cette probléma-tique, je me suis aperçue qu’il y avait, à présent, une surévaluation des attentes des individus par rapport à leur travail. Ce qui pour moi est très frappant est d’entendre de nombreux patients dire qu’ils ne sont ni reconnus ni respectés. Les managers affirment, de leurcôté, que les salariés ne sont ni motivés ni créatifs. Je remarque que ce n’est ni la rentabilité, ni la qualité du travail qui sont recherchées, mais des valeurs proprement personnelles, humaines. À partir de là, lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, cela génère malheureusement bien souvent frustration, dépression, sentiment d’inutilité, etc. De plus en plus de salariés vont s’épuiser professionnellement, faute de parvenir à satisfaire la demande de leurs employeurs.
Dans un autre chapitre consacré aux violences dans le couple, vous dites que la culpabilité a changé de camp...
Oui. J’ai été, à mes débuts, frappée par le rapport à la violence conjugale. Un rapport entre les hommes et les femmes qui me paraissait un peu extraordinaire car certaines patientes considéraient que si elles étaient un peu rudoyées par leur mari ou leurs compagnons, elles pouvaient, après tout, l’avoir bien cherché. À cela, s’ajoutait la vulgate psychanalytique qui consistait à dire qu’une femme battue était, quelque part, une femme qui, inconsciemment, cherchait à se faire battre. Le problème était invariablement à chercher du côté de ces femmes.
Au point que les thérapeutes eux-mêmes les rudoyaient en leur disant qu’elles n’avaient qu’à se prendre en main. Tout cela était évidemment totalement inefficace. Je pense et j’espère que cette approche-là n’est actuellementplus soutenable. On ne peut plus dire à une femme battue qu’elle le cherche. L’accent est désormais mis sur la personnalité du mari. D’ailleurs, je raconte dans le livre que, vers la fin des années 1990, a émergé le profil du mari pervers narcissique. Le trouble de la personnalité est passé chez le mari. Je relie bien sûr ce glissement aux évolutions de la société et aux mouvements féministes, mais il était déjà présent avant et est, je crois, assez profond.
Concernant les addictions, en 1984, on vous consultait pour une cirrhose, aujourd’hui pour une addiction à la cocaïne. Qu’est-ce qui s’est modifié ?
Jusqu’à la fin des années 1990, lorsque l’on prenait en charge un drogué (pour parler simplement) ou un alcoolique, l’objectif principal était qu’il devienne abstinent. Il n’y avait pas d’autres options. Les personnes souffrant d’addictions enchaînaient donc sevrage, postcure, rechute, sevrage, post-cure, rechute, etc. Et puis le sida est passé par là et on a remis complètement en cause la façon de prendre en charge les toxicomanes qui utilisaient des substances illicites. On a développé les traitements de substitution, les lieux d’accueil pour des gens qui continuent à consommer. Tout cela avec l’idée qu’une personne sujette à une addiction n’est pas en mesure d’arrêter de consommer. C’est ce que l’on appelle la politique de réduction des risques. Elle a été transposée non explicitement, mais dans les faits, à l’alcool. J’ai pu le constater car j’ai soigné des alcooliques dans les années 1980, puis j’ai arrêté et recommencé dans les années 2010. J’ai vu ma pratique et celle de mes confrères complètement modifiée : lorsqu’un patient arrivait, on ne lui intimait pas l’ordre d’arrêter l’alcool à tout prix. On essayait plutôt devoir avec lui de quelle manière il pouvait améliorer la situation et quelles étaient ses capacités à diminuer sa consommation.
Vous ne cherchiez plus à conduire le patient vers l’abstinence ?
En effet, l’abstinence n’était plus l’alpha et l’oméga de la prise en charge des personnes alcooliques ou usagères de substances. Comme on dit, « le mieux est l’ennemi du bien », et parfois il faut composer avec les possibilités réelles des gens. C’est un changement très important de prise en charge. Et puis, au lieu
qu’il y ait, comme jadis, deux filières distinctes, à savoir les soins aux alcooliques et les soins aux toxicomanes, ne
demeure désormais qu’une seule structure. Au lieu de parler d’alcoolique ou de toxicomane, on parle désormais de personne souffrant d’addictions. Cela traduit le fait que l’on s’intéresse davantage au comportement de consommation plutôt qu’au produit consommé.
[lireaussi:7364]
Parmi les autres sujets que vous abordez dans le livre, il y a aussi la condition « d’être vieux ». Qu’est-ce qui, selon vous, a évolué ?
Dans les années 1950, on était considéré comme vieux à 60 ou 65 ans. Aujourd’hui, on commence à l’être à 80 ans. Le curseur se déplace parce que la santé des individus s’améliore. Avec
l’extrême vieillissement de la population, les sujets dont on parle s’agissant des personnes âgées ou très âgées sont l’Alzheimer et la fin de vie. J’ai 74 ans et je constate régulièrement autour de moi que la crainte est de perdre la tête et de devenir dément.
C’est une source d’inquiétude pour les personnes d’un certain âge ainsi que pour leur entourage. Je me souviens qu’il y a quarante ans, les déments étaient simplement placés en Ehpad voire en asile psychiatrique. La question des aidants a, elle aussi,
émergé ces dernières années. On commence maintenant à se préoccuper des personnes qui prennent en charge leurs parents ou leurs conjoints atteints de démence. Ce que j’ai également découvert en écrivant ce livre est le taux de suicide des personnes âgées. Il est extrêmement important et ne préoccupe pas grand monde. Quand cela concerne un vieux, on ne se pose peut-être pas la question de savoir s’il s’agit d’une carence dans la prise en charge ou bien de l’exercice d’un droit de mourir, que la personne prend en charge toute seule. Je pose la question,je n’ai pas la réponse.
Si vous deviez faire un bilan de tous les domaines que vous avez examinés, les Français se portent-ils mieux ou moins bien qu’il y a quarante ans ?
Subjectivement, les gens vont moins bien. C’est comme la météo, il y a la température ressentie et la température réelle. Mais enfin, si vous faites des sondages et demandez aux Français comment ils vont, les chiffres sont assez préoccupants. Comme je le disais, les individus se préoccupent davantage de leur santé mentale, et ne trouvent pas facilement de psychiatre pour répondre à leurs besoins. La prise en charge psy est sinistrée en France. L’offre de soins de qualité est largement insuffisante. Le résultat de tous ces facteurs est assez explosif. Je remarque aussi que les médicaments sont bien souvent la réponse la
plus facile aux problèmes. Si vous ne dormez pas, on vous prescrit un somnifère ; si vous êtes anxieux, un anxiolytique ; si vous êtes déprimé un antidépresseur. Les médecins généralistes – qui bien sûr font ce qu’ils peuvent – prescrivent assez facilement des molécules. En résumé, ce qui me préoccupe, c’est cet effet ciseaux entre un ressenti et des demandes beaucoup plus importantes, une offre insuffisante et finalement une réponse thérapeutique limitée à la prescription de
médicaments qui n’est absolument pas satisfaisante.
[lireaussi:9111]
Si vous deviez écrire un autre livre dans quarante ans, où en serait-on d’après vous ?
De multiples choses pourraient être améliorées si des politiques publiques astucieuses étaient mises en place. De nombreux étudiants sortent, chaque année, diplômés des facultés de psychologie. Ils pourraient utilement travailler de concert avec les trop rares psychiatres, pourvu qu’il y ait un système
de remboursement correct de la prise en charge par des psychologues. On pourrait imaginer un dispositif dans lequel
vous auriez un médecin psychiatre qui rencontrerait les patients une première fois puis, le cas échéant, les adresserait au psychologue. Je pense que cela démarre là : lorsque vous commencez à vous sentir mal, vous pouvez rapidement trouver un professionnel pour vous aider, trois ou quatre entretiens peuvent parfois suffire. Il s’agirait là d’une véritable prévention du développement de troubles plus importants.
Il faudraitcomplètement revoir le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi que le budget de la psychiatrie. Des mesures
politiques pourraient être prises immédiatement. Pour l’instant, cela n’en prend pas le chemin.
[lireaussi:8748]
Quelles mesures pourrait-on adopter ?
J’ai évoqué le problème du vieillissement. Il y aurait des façons de prévenir un certain nombre de troubles et de les prendre en charge. Si je prends l’exemple des benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques, il s’agit d’un facteur absolument reconnu de troubles démentiels. Les benzodiazépines favorisent les confusions, les pertes de mémoire, entre autres effets délétères. Tout cela est corrélé. À propos des plus jeunes, je suis très
préoccupée par le manque de pédopsychiatres. Je l’évoque dans l’ouvrage, il y a un déficit au niveau de la prévention
des troubles de la relation parents-enfants. Cela commence dès la naissance et cela se poursuit avec la médecine scolaire.
Bref, la mise en place d’un dispositif préventif efficace permettrait, sans doute, que seule une petite partie de la population ne développe des troubles avérés. Tandis que si l’on ne fait rien, le ressenti sera évidemment beaucoup plus vaste. Pour l’instant, je ne vois malheureusement pas de possibilité
d’être réellement optimiste sur l’évolution des choses...
Que s'est-il passé dans la tête des Français ? de Sylvie Wieviorka, éditions Buchet Chastel.
[lireaussi:8309]
[lireaussi:8981]

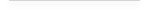 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro 
















































































