Accueil Polémiques Levothyrox nouvelle formule : les patients avaient raison
Levothyrox nouvelle formule : les patients avaient raison
Sept ans après « la crise du Levothyrox », on commence enfin à comprendre ce qui s’est passé. Au printemps 2024, une étude tchèque, passée quasi inaperçue, a révélé la présence d’impuretés dans les boîtes de la nouvelle formule. Retour sur cette affaire, dans laquelle des milliers de plaignants attendent toujours réparation par la justice…
Suite à la publication de l’article, et comme la loi l’y autorise, le laboratoire Merck a souhaité publier un droit de réponse que vous pourrez lire en cliquant ici. En conséquence de quoi nous avons apporté des modifications à notre article initial, en prenant acte du démenti formel du laboratoire sur l’existence d’une « seconde nouvelle formule », et en intégrant notamment les sources utilisées pour quantifier les effets indésirables cités dans l’article, ou encore les citations exactes de la Cour de cassation sur les avancées judiciaires du dossier.
L’affaire du Levothyrox commence par ce qu’on pourrait appeler une « bonne intention » : en 2012, l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) demande à Merck de « resserrer » la formule de son médicament. Il s’agit d’augmenter sa stabilité, et sa durabilité.
Le Levothyrox ? C’est depuis 1999, date de sa mise sur le marché, un blockbusterdes laboratoires Merck. En France, plus de trois millions de personnes le prennent au quotidien. Il contient de la lévothyroxine , une hormone déficitaire quand la thyroïde ne fonctionne plus ou est en sous-régime, ce qui est le cas dans l’hypothyroïdie ou après ablation de la thyroïde.
Dans sa « recette », Merck utilise du lactose, un excipient à effet notoire susceptible de modifier la quantité de lévothyroxine délivrée par le comprimé. Ce qui le conduit à surdoser de 5 % environ le Levothyrox en lévothyroxine afin de maintenir cette hormone ultrasensible « au meilleur taux ». Dans ce médicament, le principe actif n’est présent qu’à hauteur de quelques microgrammes. Le reste, ce sont les excipients, qui doivent permettre au principe actif de ne pas être altéré dans le comprimé, de franchir sans encombre l’estomac et ses sucs acides, la barrière intestinale, etc.
Pour répondre à la demande des autorités, Merck fait évoluer sa formule afin de la rendre à nouveau conforme à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) qui lui avait été délivrée. Il y apporte une modification considérée comme mineure : il remplace le lactose par un mélange de mannitol – sucre que l’on trouve dans les confitures et les chewing-gums – et d’acide citrique. Les autres excipients restent inchangés.
Nouvelle formule du Levothyrox : des patients suspectés « d'hystérie collective »
Au printemps 2017, cette nouvelle formule du Levothyrox apparaît exclusivement sur le marché français, l’ancienne formule en étant du même coup retirée. Mais quelques semaines plus tard, les centres de pharmacovigilance saturent sous les notifications d’effets indésirables chez des patients qui étaient jusqu’à présent sous ancienne formule ! Le standard de l’association française des malades de la thyroïde (AFMT) explose. La presse est mise au courant, le scandale devient public. Et occupe la scène médiatique durant tout l’été 2017.
Les autorités sanitaires évoquent un « effet nocebo » lié au changement de couleur des boîtes (!), puis une « crise médiatique », et même une « hystérie collective » nourrie par les réseaux sociaux. Ce qui est pour le moins un peu exagéré, pour rester poli : « L’utilisatrice type du Levothyrox est une femme de 65 ans, pas branchée sur son ordinateur, rappelle le Dr Philippe Sopena, conseiller scientifique de l’AFMT, qui poursuit : à l’époque,les patients disent “je vais mal”… et ils ne savent pas pourquoi. »
Plutôt que de prendre au sérieux leurs plaintes, les autorités leur répètent, ainsi qu’aux médecins qui les traitent, que ce nouveau médicament est « pareil, mais mieux» que l’ancien. Malgré cette stratégie de forçage, quelque 30 % des patients décident d’arrêter la nouvelle formule… pour reprendre l’ancienne. Et s’en trouvent bien mieux. Débrouillards, ils trouvent des filières pour se procurer le Levothyrox ancienne formule (AF), qui continue d’être fabriqué et qui reste distribué dans de nombreux pays. Des valises transitent ainsi depuis l’Allemagne, l’Espagne, le Maroc… En parallèle, une pétition exigeant le retour de l’ancienne formule recueille plus de 250 000 signatures.
À l’automne, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, autorise officiellement l’importation de l’ancienne formule – qui est toujours fabriquée en Allemagne – pour les seuls patients qui ne supportent pas la nouvelle. Elle ouvre aussi le marché à d’autres médicaments à base de lévothyroxine. Les victimes du Levothyrox commencent à porter plainte, elles attendent qu’on leur explique pourquoi elles ont été malades ; d’autant que les enquêtes de pharmacovigilance excluent tout lien avec le médicament.
Des pics d’impuretés dans la nouvelle formule de Levothyrox
En octobre 2018, un chercheur toulousain, Jean Christophe Garrigues, analyse les deux formules du Levothyrox . Comme nombre de chercheurs et médecins qui vont s’impliquer dans la recherche des causes, il est directement concerné par le problème : sa mère s’est trouvée terriblement mal à la suite du changement de formule. Il veut comprendre. Alors, cet ingénieur du CNRS, spécialiste de la chromatographie, étudie la composition du Levothyrox et observe des pics « d’impuretés » (lire l’encadré ci-dessous) plus importants dans la nouvelle formule que dans l’ancienne. Les résultats sont contestés par son institution de tutelle, le CNRS. Ils intéressent néanmoins un laboratoire tchèque de haute renommée, spécialisé en chimie analytique. Et ses chercheurs, avec la collaboration de Jean Christophe Garrigues, vont entreprendre d’analyser tous les échantillons de Levothyrox – ancienne et nouvelle formule –, qui avaient pu être collectés par les patients et précieusement conservés. La publication, parue en ligne dès mars 2024 dans une revue à comité de lecture (1) confirme les premiers soupçons : il y a bel et bien des pics d’impuretés plus importants dans la nouvelle formule ! On le savait, mais cela se confirme : les excipients sont des éléments déterminants dans la formule du médicament.
Phospholipides, mannitol, amidon de maïs : quelles impuretés dans le nouveau Levothyrox ?

Les impuretés consistent en des composés inattendus, qui ne figurent donc pas dans la liste des ingrédients du médicament : ce sont des produits de réactions chimiques survenant entre les excipients, ou entre les excipients et le principe actif, mais ce sont surtout des phospholipides – qui n’étaient pas déclarés ! – qui proviennent probablement de l’ amidon de maïs utilisé comme excipient… Selon les auteurs de l’étude parue dans Journal of Pharmaceutical Analysis (1), ces impuretés expliqueraient bien des choses, à commencer par la différence de biodisponibilité des différentes formulations. L’acide citrique suffit à modifier la solubilité de la lévothyroxine (et donc sa biodisponibilité) ; quant aux phospholipides ou au mannitol, ils sont susceptibles d’altérer l’absorption intestinale…
Une « 2e nouvelle formule » ?
En France, la crise du Levothyrox a duré jusqu’au printemps 2018. Certes, seul un faible pourcentage (1,4 %) des plus de 2 millions de patients Français qui sont passés à cette nouvelle formule ont signalé des effets indésirables, allant de la dépression sévère à la chute de cheveux en passant par la fatigue intense ou les vertiges . Mais cela représente tout de même 31 411 patients ! (2) Pour certains patients, l’issue est tragique : 11 décès sont rapportés par les familles à l’AFMT, même si aucun lien n’a pu être établi avec le médicament.
À compter de l’été 2018, le nombre de signalements d’effets indésirables des médicaments à base de lévothyroxine (Levothyrox nouvelle formule compris) devient insignifiant…
Une « fin de crise » que le Dr Sopena, conseiller scientifique de l’AFMT, questionne : n’y aurait-il pas eu une « deuxième nouvelle formule » du Levothyrox corrigeant les défauts de la première ? Introduite au printemps 2018 en Suisse et autorisée sur l’ensemble du marché européen en juillet de la même année, cette hypothétique « seconde nouvelle formule» aux effets indésirables bien moindres aurait-elle remplacé en France la toute première nouvelle formule problématique ?
Faute d’avoir accès aux dossiers d’AMM, difficile d’en savoir plus. Mais il est notable qu’aucun pays n’ait notifié autant d’effets indésirables que la France lors du changement de formule. Sans insinuer que les Français qui en ont eu la primeur en 2017 ont pu servir de cobayes, n’auraient-ils pas fait les frais d’un problème rectifié depuis ? D’ailleurs, la publication tchèque citée plus haut a révélé un pic bien plus important d’impuretés dans les lots mis sur le marché au printemps 2017 que dans les lots suivants… Quoiqu’il en soit, le laboratoire a formellement démenti l’existence d’une telle « deuxième nouvelle formule » dans leur droit de réponse à cet article.
Justice : quelques avancées…
« 10 000 plaintes ont été déposées au civil et autant au pénal, et ce ne sont souvent pas les mêmes plaignants !» résume le Dr Philippe Sopena. Plusieurs avocats ont en charge divers dossiers, chacun avec leurs méthodes, au tribunal de Paris, de Marseille, de Valence, etc. Comme souvent, la justice traîne et n’a que peu de moyens : à Marseille, une nouvelle juge d’instruction vient seulement d’être nommée alors que le dossier pénal est au point mort depuis un an.
Les responsables cherchent à gagner du temps, estime le Dr Sopena : en juin 2023, Merck a contesté, in extremis, au bout du délai légal de six mois dans lequel il pouvait le faire, le bien-fondé de sa mise en examen de fin 2022 ; et la chambre d’instruction d’Aix-en-Provence qui instruit sa contestation vient juste de se réunir à huis clos, le 5 décembre dernier… soit avec un an et demi de retard sur ce que prévoient les textes qui réglementent son fonctionnement.
Au plan civil, on note cependant une décision importante, en date du 14 novembre, et qui fera jurisprudence. La Cour de cassation a annulé un arrêt prononcé en mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier. Cette dernière avait rejeté les demandes d’indemnisation de 45 plaignants de Haute-Garonne, représentées par maître Jacques Levy (avocat au barreau de Toulouse), au motif que le lien de causalité scientifique ne pouvait être scientifiquement établi. Selon l’arrêt prononcé, « même si dès la mise sur le marché du Levothyrox NF le signalement d'effets indésirables par les utilisateurs a connu une augmentation significative, il n'est pour autant pas scientifiquement rapporté la preuve d'un lien entre le produit et les dommages invoqués. ».
Or le 14 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé ce jugement au motif d’une violation de l'article 1245-8 du Code civil, ce jugement opposant «à la démonstration probatoire des patients une absence de certitude scientifique, au lieu de se satisfaire de l'établissement, par eux, de présomptions graves, précises et concordantes de nature à permettre de retenir que les pathologies et troubles dont ils souffraient étaient imputables au Levothyrox NF ». (Les passages entre guillemets sont les citations exactes du jugement de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 [3]).
Ainsi, ce qu’établit la Cour de cassation, c’est que l’absence de lien de causalité scientifique ne suffit pas à démontrer l’absence de lien de causalité juridique et que les plaintes des patients peuvent être reconsidérées. Ce qui pourrait ouvrir la voie à l’indemnisation de milliers d’entre eux - trop vite qualifiés de fous ou d’hystériques - qui sont passés à la nouvelle formule du Levothyrox entre avril 2017 et mars 2018.
Une étude de bioéquivalence biaisée

La nouvelle formule du Levothyrox a été autorisée sur la base d’une étude de bioéquivalence qui « n’aurait jamais été acceptée dans une revue à comité de lecture » , déplore le Dr Jacques Guillet de l’AFMT. Mais l’ANSM a su fermer les yeux ! Par exemple, l’étude comparait les effets biologiques de l’ancien et du nouveau médicament sur des volontaires sains. Mais « ces volontaires étaient particulièrement nombreux : 200 contre 25 habituellement ! De plus, la dispersion [au sens statistique, NDLR] des résultats était telle qu’on pouvait prévoir qu’il y aurait des problèmes cliniques au passage de l’ancienne à la nouvelle formule», poursuit le médecin. S’agissant d’évaluer un médicament à marge thérapeutique aussi étroite [pour lequel les concentrations toxiques sont proches des concentrations efficaces, NDLR], l’étude de Merck laisserait donc à désirer. En 2019, sa pertinence a d’ailleurs été remise en cause dans une publication scientifique (4)
Références et notes
1.H. Chmelařová, M. C. Catapano, J. C. Garrigues et al., "Advancing drug safety and mitigating health concerns: High-resolution mass spectrometry in the levothyroxine case study", dans Journal of Pharmaceutical Analysis, en ligne le 28 mars 2024
2. Chiffres issus du 3 ème rapport du Comité technique de pharmacovigilance de l’Ansm paru le 06/07/2018 accessible librement ici (voir en particulier les pages 9, 10 et 11)
3. Décision de la Cour de cassation - Première chambre civile,14 novembre 2024 / n° 23-19.156, accessible librement ici.
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


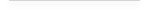 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro  Levothyrox nouvelle formule : les patients avaient raison
Levothyrox nouvelle formule : les patients avaient raison
Levothyrox : l’ANSM mise en examen
Témoignages : lévothyrox nouvelle formule
Thyroïde, les solutions naturelles
Overdose – Comment la surconsommation de médicaments nous tue
Nodules, Hashimoto, Basedow et autres maladies thyroïdiennes auto-immunes : la brunelle au secours de votre thyroïde ?
Association de patients : au service de l’industrie ?